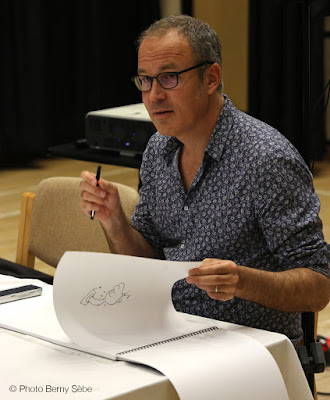Pour le dernier événement de cette année universitaire, nous
accueillons Zabou Breitman, comédienne, réalisatrice et metteuse en scène à la
bonne humeur communicative, et, de son propre aveu, avec une forte « tendance
à l’enthousiasme », qui gagne rapidement le public. Une quinzaine de jours
avant son arrivée à Oxford, Zabou a été maîtresse de cérémonie pour la
trentième Nuit des Molières, et c’est donc par l’évocation de cet événement récent
que commence notre rencontre. Entre les nombreuses répétitions et le passage en
revue des cérémonies précédentes, nécessaires pour se préparer et
« trouver le bon ton », Zabou se démarque en ajoutant quelque chose
qui lui semblait manquer : il lui paraissait important, lors de cette soirée,
d’ « honorer les
collègues » qui se trouvaient face à elle et allaient recevoir des prix.
Cette trentième cérémonie, elle est d’ailleurs la première
femme à la présenter seule. Zabou, qui s’est toujours sentie légitime dans le
milieu du théâtre et du cinéma, grâce surtout à son père féministe, se rend
compte aujourd’hui d’être un contre-exemple, et insiste sur la nécessité de
donner aux femmes les armes et les outils nécessaires pour se défendre et
tracer leur route. Et, dans le milieu du cinéma, la route est encore longue :
pour la série télévisée Paris etc. qu’elle
réalise en 2017, nombreux sont les acteurs qui ont refusé de jouer les rôles
secondaires au côté des cinq femmes protagonistes, ces rôles secondaires sont
en effet souvent réservés aux actrices, tandis que les hommes occupent
d’habitude les rôles principaux.
Fille d’un scénariste et d’une actrice, Zabou a commencé à travailler
dans le cinéma presque instinctivement. Elle joue son premier rôle à la
télévision à cinq ans, dans la série Thierry
La Fronde, écrite par son père. Mais plutôt que comme actrice, elle préfère
se définir d’abord comme une « créatrice », quelqu’un qui aime
« fabriquer ». Si sa carrière d’actrice débute tôt, la passion du
métier lui est venue plus tard. D’ailleurs, elle n’a jamais perçu comme une
limitation le choix presque « naturel » que constituait pour elle
cette voie. Son père lui a inculqué très tôt l’idée qu’elle pouvait « tout
faire » ; et ses parents ont insisté sur l’importance des études,
surtout « pour apprendre à apprendre ». Malgré l’ennui qu’elle
ressent à passer son adolescence à la campagne, et malgré son côté « poète
maudite », selon ses propres mots, Zabou, enfant, est amusée et intéressée
par plein de choses. Elle ne s’est jamais sentie limitée dans ses goûts et ses
intérêts : tout lui plaît, à condition de constituer un « challenge
artistique », et elle se passionne pour le dessin, en particulier le
croquis.
C’est au début des années 1990, que commence véritablement sa
carrière cinématographique, mais elle se retrouve au départ cantonnée à la
comédie, sans pour autant s’en sentir frustrée ou déçue. Elle note néanmoins un
rapport au rire différent selon les pays : en France, faire rire est
« suspect », ce qui rend difficile une carrière en tant qu’actrice
comique, tandis que c’est l’inverse en Angleterre. Même si elle se dit contente
de travailler comme actrice, elle s’autorise quelque chose de différent et
prend son destin en main, en 2001, lorsqu’elle réalise son premier film, Se souvenir des belles choses, avec
Isabelle Carré et Bernard Campan. En se lançant dans la réalisation, Zabou a
retrouvé sa première passion, le dessin, ou plutôt a réussi à combiner cette
passion avec celle du cinéma. Enfant, elle dessinait des croquis et des storyboards, et au moment de réaliser
ses films, la première étape est toujours de « penser en images ».
Elle travaille souvent avec un scénariste et met alors en place un processus
d’écriture à deux : elle s’approprie d’abord une scène en la visualisant,
et le scénariste l’écrit. Ce rapport très visuel, sensoriel, au travail de
réalisation semble être la preuve de sa conviction qu’un savoir encyclopédique
du cinéma n’est pas nécessaire pour réaliser un film. Néanmoins, ce qui lui
semble nécessaire, c’est de se comporter en « spectatrice active »,
ce qu’elle fait depuis son plus jeune âge. En effet, durant son enfance, elle
acquiert une culture filmique et une connaissance du vocabulaire
cinématographique d’une façon qui lui paraît complètement naturelle :
devant la télévision, son père décortique les plans avec elle, et elle se
familiarise ainsi avec des cinémas différents (français, russe, anglo-saxon...).
Regarder de manière active, pour Zabou, c’est donc un mélange entre cette connaissance
et une « intuition joyeuse » qui se retrouve dans son travail de réalisation.
Tout comme la recherche scientifique, la réalisation contient pour elle cette
part d’intuition que même une connaissance extrêmement complète ne saurait
remplacer.
A plusieurs occasions, Zabou a dû, sur un même tournage,
endosser le rôle d’actrice et de réalisatrice, un exercice très compliqué et
auquel elle ne se prête pas volontiers. Par exemple, pour la très récente série
de Canal + Paris etc. dont elle est
la réalisatrice, elle a accepté de jouer le rôle d’une des protagonistes à la
demande de la chaîne et de la production. Mais le fait d’être à la fois
comédienne et réalisatrice lui permet aussi de réussir dans ces deux
rôles : lorsqu’elle est réalisatrice, son expérience d’actrice lui permet
de choisir au mieux les mots qu’elle adresse aux comédiens, pour les aider et
pour éviter de les inhiber, en leur manifestant toute sa confiance. En effet,
selon Zabou, le principe est simple : si l’acteur est choisi, il saura
faire ce qui lui est demandé, il faut donc lui accorder sa confiance. Le choix
de l’acteur est d’ailleurs une étape de la réalisation qui la passionne :
elle sait que l’acteur incarnera le personnage en se servant de son corps, de
sa voix, de son jeu, mais aussi de son « bagage », et qu’il faut donc
prendre en compte son expérience personnelle. Le fait d’être comédienne l’aide ainsi
à mieux comprendre les acteurs, mais aussi, inversement, à mieux se rendre
compte des difficultés que les acteurs peuvent occasionnellement poser aux
réalisateurs !
En plus d’être actrice et réalisatrice, Zabou est aussi
metteuse en scène, ce qui lui permet de confronter les milieux du cinéma et du
théâtre, et de relever les différences entre la réalisation d’un film et la
mise en scène d’une pièce. Le fait que le cinéma soit une industrie, et le film
un objet qui nécessite une équipe nombreuse, fait de la réalisation un
processus plus simple que la mise en scène qui est, quant à elle, un processus
« plus artisanal ». Au cinéma comme au théâtre, Zabou a travaillé à
l’adaptation de romans. L’adaptation d’une œuvre littéraire au cinéma pose
toujours la question de la fidélité à l’original, et c’est une question qui
s’est posée avec force à Zabou Breitman lorsqu’elle a dû réaliser et mettre en
scène différentes adaptations, comme celle du roman Je l’aimais d’Anna Gavalda, en 2008, ou de No et moi, de Delphine de Vigan, deux ans plus tard. Une fidélité
complète à l’œuvre originale est impossible, c’est même le médium du cinéma qui
l’interdit, et qui force à trahir : en effet, le cinéma ne propose qu’un
possible, tandis que le roman s’offre dans toute sa multiplicité à ses divers
lecteurs. Cependant, cela n’exempte pas la réalisatrice du devoir de manifester
son respect aux auteures et à leurs œuvres. La solution à ces interrogations
lui est venue de Lydie Salvayre, dont elle a réécrit et adapté pour la scène La Médaille en 2010, puis La Compagnie des Spectres : une
adaptation doit ressembler à la fois à l’auteur de l’œuvre originale et au
créateur de la nouvelle adaptation.
Pour Je l’aimais
d’Anna Gavalda, la question de l’adaptation et du respect de l’œuvre originale
se pose de façon très claire dans la forme du film même. Histoire d’un regret
amoureux, Je l’aimais est un livre
qui joue sur les temps, sur la résurgence du passé, et du souvenir que l’on
raconte, dans le présent. Pour réaliser le film, Zabou Breitman a dû développer
une véritable « grammaire » qui lui a permis de « jouer sur les
temps », à travers l’utilisation de retours en arrière, de passages de la
voix in à la voix off : ce n’est plus l’écriture qui nous catapulte dans
le passé, mais l’écoute. On retrouve dans ce film une méditation sur la
mémoire, déjà amorcée dans Se Souvenir
des belles choses, et qui parcourt l’œuvre de réalisatrice de Zabou
Breitman.
Toutefois, c’est un projet de réalisation un peu différent
qui l’occupe en ce moment : elle travaille à la réalisation d’un dessin
animé — un rêve qui se concrétise, pour elle — Les Hirondelles de Kaboul, adapté du roman de Yasmina Kadra, et
dont la sortie est prévue en 2019. Côté théâtre, elle souhaiterait monter une
compagnie composée aux trois-quarts de jeunes comédiens de moins de trente ans.
Pour quelqu’un qui « aime fabriquer », comme Zabou Breitman, les
rêves se concrétisent souvent, et se transforment vite en projets, que nous ne
manquerons pas de suivre de près.
Événement organisé par Dr Michael Abecassis,
Cinéma et Culture Française à Oxford
Article rédigé par Virginie Trachsler